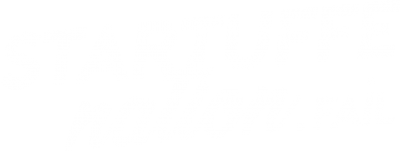Cet article nous vient du numéro 9 de la Revue Z, paru à l’hiver 2015-2016.
« Tu vois, le monde est divisé en deux : il y a les gens qui travaillent, qui vont chercher leurs enfants à l’école, qui font leur petite vie… Et il y a les gens qui innovent. »
Richard, conseiller en innovation, rencontré lors d’un « hackathon » à Toulouse.
Pour obtenir une interview avec un élu de Toulouse-métropole, j’ai expliqué à la chargée de communication que nous faisions une enquête sur la notion d’innovation. « Ah, ce n’est pas politique… très bien !, a-t-elle répondu. Dans ce cas, je n’aurai aucun problème à vous obtenir une interview. »
C’est donc un conseiller municipal très avenant et détendu qui m’a accueillie, dans son bureau du nouveau quartier Marengo, pour parler de la question si peu politique de l’innovation. Bertrand Serp, la cinquantaine, chargé du numérique et patron d’une boîte de com’, est globalement très satisfait. Classée par la revue Challenges « ville la plus dynamique de France » en 2015, Toulouse a gagné le prix Nobel d’économie en 20141. Une de ses start-up vient de rafler le prix du jeune entrepreneur innovant2 et une autre, la levée de fonds record de 100 millions d’euros3. Avec une croissance de 16 000 nouveaux habitants par an, Toulouse est l’aire urbaine qui grossit le plus vite, bientôt troisième de France, engloutissant à toute vitesse les campagnes alentour4. Seule anomalie : c’est la seule grande ville à ne pas encore être raccordée à Paris par TGV direct, mais à moins d’un grand soulèvement populaire, la ligne pourrait ouvrir en 2024.
Bertrand Serp n’emploie jamais le mot technopole : « c’est ringard ». Dans les années 1980, le technopôle désignait un quartier périphérique, nommé comme tel et délimité dans l’espace. Aujourd’hui, le phénomène ne se laisse plus si nettement appréhender, car c’est la ville entière qui est mise au service de la recherche de pointe et structurée pour faciliter les « synergies » entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise. La technopole est devenue aussi invisible et omniprésente que l’air ambiant, constituant à la fois la toile de fond et l’objet de tout environnement urbain. Dans la bouche d’un élu 2.0 comme Bertrand Serp, le terme est donc devenu inutile, et l’idée se décline en « smart city », « lab’ city » ou « fab’ city ». Mais c’est avant tout une affaire d’« écosystème ».
Ce concept clé de l’écologie a été inventé dans les années 1930 par un botaniste britannique du nom de Sir Arthur George Tansley, qui était très proche de Freud. Tansley désigne par là qu’on ne peut comprendre la nature d’un organisme vivant qu’en étudiant sa relation avec l’environnement bien spécifique avec lequel il échange en permanence. Dans le monde technopolitain, le concept désigne le milieu le plus favorable à l’émergence de cet organisme fragile qu’est l’entreprise high tech. Or les start-up prospèrent dans les Silicon Valley comme les tritons dans les zones humides. Pour reproduire cette hybridation d’origine californienne entre industrie de guerre, ambiance potache de geeks et esprit rebelle des hackers, la tâche est double : il faut en recréer la lettre et l’esprit.
Tout d’abord la lettre, c’est-à-dire l’infrastructure. Pour cela, Toulouse est avec Grenoble l’une des mieux placées, car elle est à la fois un haut-lieu de l’industrie de guerre et une ville dotée d’une longue tradition de recherche appliquée. Dès le début du XXe, les élus socialistes toulousains ont voulu lancer, dans cette ville traditionnellement productrice de poudre explosive et de tabac, une grande industrie hydroélectrique avec l’eau des Pyrénées. Comme à Grenoble, cela débouche sur un des premiers instituts d’électrotechnique du pays. À la fin des années 1950, Toulouse et Grenoble sont les seules villes de France à avoir des filières de mathématiques appliquées ; et Rangueil, pôle universitaire situé au sud-est de la ville rose qui commence à fonctionner en 1962, est le premier campus du pays construit sur le modèle américain. En 1963, l’automatique et l’électronique toulousaines sont dopées par la décentralisation du secteur spatial, avec l’installation du Centre national d’études spatiales (CNES), de l’école d’aéronautique et de l’École nationale de l’aviation civile. Le secteur est renforcé par l’arrivée des fabricants de satellites Matra et Alcatel, qui fait passer le nombre d’entreprises d’informatique de 120 en 1982 à plus de 800 en 1989. Créé en 1968, le Laboratoire d’analyse et d’automatique des systèmes (LAAS-CNRS), est un pionnier des partenariats recherche-industrie en robotique et informatique en France. Son fondateur, Jean Lagasse, chercheur en automatique devenu directeur scientifique des usines Renault, déclarait dès les années 1980 : « Maintenant, les grands patrons des entreprises toulousaines et des petites, on se connaît, on se tutoie tous ». Un coup de fil suffit pour résoudre un problème5. »
Outre ses grands pôles universitaires tels que Rangueil, les lieux dédiés à la recherche de pointe et aux transferts recherche-industrie ne manquent pas à Toulouse. Il y a le parc technologique Basso Campo, l’agrobiopôle, qui se déploie autour de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). L’innopôle de Labège, fondé en 1983, a donné naissance en 2009 à la « vallée de l’internet des objets », regroupant une vingtaine de start-up spécialisées dans les algorithmes, les objets connectés et le cloud computing. Le cancéropôle, inauguré en 2014 sur le site de l’ancienne usine d’engrais AZF qui a sauté, représente un investissement total de 1 milliard d’euros, en grande majorité des fonds publics6. Mais l’appétit de connaissances est décidément sans limites, car dans le prolongement de Rangueil, on s’apprête à créer un gigantesque « campus de l’innovation » de 56 hectares, « Montaudran aérospace » : 240 000 m2 de labos.
Mais ce n’était toujours pas suffisant. Comme 14 villes du pays, Toulouse a obtenu le « label French Tech », initiative du ministère de l’Économie lancée en 2013 dont « l’objectif est de faire de la France entière un vaste accélérateur de start-up » en construisant « un réseau d’écosystèmes attractifs », avant tout aux yeux d’investisseurs étrangers. Pour signifier son total dévouement aux entreprises, la ville s’est affublée d’un slogan original – « Toulouse, so start-up ! » – et a dû financer la construction d’un temple : le bâtiment Quai des savoirs, 30 millions d’euros, futur QG de tout un « quartier des sciences » qui prendra sa place dans le centre historique de Toulouse. Le temple hébergera la Cantine numérique, lieu d’expo et de coworking ouvert au centre-ville par La Mêlée. Pièce maîtresse du fameux écosystème, ce regroupement des entreprises du numérique de la région organise pour ses membres des voyages dans la Silicon Valley, des ateliers numériques pour les vieux et des « coding goûters » pour les petits. Mais aussi de réjouissants « hackathons ».
C’est un vendredi soir à Toulouse. Appâté par un flyer, vous vous retrouvez à l’Artilect, le premier fablab de France, devant une table de verres en plastique et de boissons sans alcool. C’est un lieu alternatif, si l’on entend par là un lieu où tout le monde se tutoie, où la peinture n’est pas finie et où les tours de ménage sont écrits à la craie à l’entrée. « Il y a des sacs de couchage et des matelas de sol pour ceux qui dorment là », annonce une jolie blonde d’une trentaine d’années. La plaquette dit que ce soir, c’est le spin off de l’innovation jam du hackathon Hack the factory. Comprendre ce qui se passe ici n’a rien à voir avec le fait d’être bilingue, il faut s’y intéresser. C’est donc la soirée de lancement de 48 heures de folie pendant lesquelles on va se répartir par équipes pour innover le plus possible en imaginant l’ « Usine du futur ». Les gagnants verront leur projet de start-up « incubé ». Malgré le lexique, ce n’est pas pour pirater le système qu’on se réunit ici : « Usine du futur » est l’un des plus gros programmes de recherche européen du moment et vise à rendre les usines du continent plus compétitives grâce aux technologies de l’information et de la communication. L’événement est à l’initiative d’Airbus et a pour partenaires l’IRIT, le LAAS et Toulouse-métropole.
« L’innovation ne se fait pas dans les laboratoires de recherche ou dans les grands groupes », entonne Didier Bichard, directeur du laboratoire des usages de La Mêlée, dont le but est de rapprocher l’innovation des usagers, d’où l’Open innovation, « une démarche pour faire réfléchir des gens qui n’auraient pas réfléchi dans un autre écosystème ». Le hackathon est une application à la lettre d’un des préceptes fondamentaux de la technopole, le brassage. Pierre Lafitte, fondateur de Sophia-Antipolis, première technopole française, préconisait en 1985 « de payer la matière grise nécessaire pour faire en sorte que les gens se rencontrent, discutent et s’amusent ensemble (…). Il faut, bien sûr, laisser le libre contact. Mais il est indispensable en revanche de prévoir les lieux de ce contact7. » S’y ajoute la culture hacker, constitutive de l’esprit Silicon Valley (« Le hack, explique la chargée de com, c’est l’esprit bidouille, l’idée que tu peux créer toi-même selon ton envie ») qui fait souffler un vent rebelle sur l’événement et nous ferait presque oublier qu’on va bosser pendant tout un week-end gratuitement pour Airbus.
Dans l’assistance, nous sommes une trentaine : d’âge moyen mais plutôt jeunes, plutôt blancs. En fait de brassage, il n’y a aucun ouvrier pour penser l’usine du futur, pas même un syndicaliste. Didier Bichard détaille les « défis » autour desquels vont se répartir les groupes : « la green usine » ; « co-transmission générationnelle : comment transmettre un savoir-faire professionnel de l’homme à la machine ? (sic) ». Mon groupe, composé notamment d’Alain, qui dirige des plans d’innovation stratégiques chez Airbus, de Rachida, cadre dans l’aéronautique et de Fabrice, conseiller en innovation, planche sur l’entreprise empowered, l’entreprise libérée. Mes discrètes références à l’autogestion sont rapidement canalisées, et on se retrouve à plancher sur un projet de « boîte à idées interactive » – une appli mobile permettant de projeter un message sur un « mur à idées interactif ».
Bertrand Serp conclut son interview en définissant son rôle d’élu comme étant de « pousser les industriels dans leur stratégie d’innovation ». Dire cela, ce n’est pas tout à fait comme dire « mon rôle d’élu est d’aider les industriels à gagner de l’argent », même si c’est concrètement ce qu’il fait. Si la phrase n’a rien de si cru, c’est que le terme d’innovation renvoie à quelque chose de plus large, quelque chose qui ne serait pas totalement détaché de l’intérêt public. Comme les mots « développement » ou « progrès », il dissimule une dynamique industrielle prédatrice sous un terme consensuel. Cette ambiguïté est essentielle pour comprendre l’absence de contestation du rôle de la recherche et de l’organisation du territoire autour de l’innovation8. Elle est aussi essentielle à la chaîne de production elle-même, car elle joue à plein pour entretenir les chercheurs dans la fausse conscience de la quête de connaissance désintéressée9. Tout problème de la société d’aujourd’hui, de la crise climatique aux inégalités sociales, ne trouve-t-il pas sa solution dans la « recherche » ? Ne s’agit-il pas de connaître et de comprendre ? L’ « innovation » a beau structurer les villes et les territoires d’une façon extrêmement précise, afin de produire une famille d’objets bien précise, toute critique est immédiatement entendue comme une mise en cause du désir de connaissance et de changement social sens large. L’innovation renvoie à l’idée de « changer le monde ». Et qui ne veut pas changer le monde ?
Probable que pour les « 1000 à 2000 personnes », selon l’estimation d’un jeune startupper, « qui réseautent autour de l’innovation à Toulouse » – consultants, animateurs, entrepreneurs, élus – changer le monde passe avant tout par la mise au point de nouvelles marchandises, qui transforment, via les usages, les mœurs et les valeurs de la société. Effectivement, les start-up toulousaines de drones ou d’objets connectés vont changer le monde, au sens où elles – ou d’autres – vont bousculer les modes de vie, de gré ou de force. Mais ce parcours à travers les technopoles fait apparaître que ce qu’on appelle innovation recouvre en fait une dynamique à la fois extrêmement étroite et conservatrice. Étroite car, en fait d’inventivité et d’audace, on applique les mêmes recettes et on développe les mêmes technologies – nano-biotechnologies, robotique, informatique, génétique – dans toutes les technopoles du monde, qui sont en concurrence directe. Une dynamique conservatrice d’autre part, en ce que l’innovation, en tant que moteur essentiel du capitalisme industriel10, perpétue et prolonge les spécificités de ce système créé à la fin du XVIIIe siècle : destruction des cycles naturels par l’exploitation des ressources et l’accumulation de déchets ; division sociale ; chômage ; exploitation du reste du monde par les plus grandes puissances économiques et mise à distance de toutes ces impasses par l’invocation d’un « progrès » à venir. Pour changer le monde, il est donc urgent de mettre un frein à l’innovation.
L’entretien se termine. « Monsieur Serp, puisque j’imagine que vous avez vous aussi fait votre pèlerinage à la Silicon Valley… » A cet instant, Bertrand Serp, spécialiste de la communication, est un petit garçon qui rougit, décomposé : « Euh… non, j’ai raté plein d’occasions… C’est idiot… En fait je ne suis jamais allé dans la Silicon Valley. »
Notes: