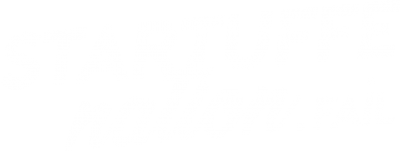Le modèle technopolitain fondé sur la recherche-innovation s’est imposé à toutes les grandes villes. À l’origine conçues comme un moyen de dépasser les contradictions d’une économie fondée sur la consommation de masse et la destruction de la nature, ces «villes de la connaissance» en sont devenues le principal moteur. Comment passe-t-on du «small is beautiful» au nouveau gigantisme industriel ?
Texte : Celia IzoardCe texte a été publié dans le n°9 de la Revue Z, paru à l’hiver 2015-2016.
Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu’une ville française annonce un projet de technopole scientifique. Les technopoles suscitent un intérêt égal dans les administrations centrales ou décentralisées, les collectivités locales, les chambres de commerce… La fièvre s’est emparée de tous ces acteurs qui ne rêvent plus que de fertilisation croisée.» Voici ce que l’on pouvait lire dans un article consacré aux technopoles en … 1985. Dans le même numéro de la revue Autrement1 , le journaliste Philippe Merlant publie un petit lexique du jargon technopolitain : pépinière, synergie, transfert, incubateur, fertilisation, brassage, réseau… Tous les mots qui comptent triple aujourd’hui, mots qui justement renvoient à tout sauf au passé, évoquant plutôt une course échevelée vers l’avenir ou la science-fiction, sont déjà présents dans leur sens actuel. À l’entrée «innovation», le journaliste écrit que le terme est «déjà un has been».
Has been, l’innovation ? Trente ans plus tard, le mot est dans toutes les bouches. Elle est devenue l’autre nom du développement, le maître-mot de la restructuration des territoires. L’innovation est sacro-sainte. L’innovation est le nom de ce qu’il faut faire. Le modèle de la technopole, loin d’être une simple mode, s’est imposé comme avatar quasi hégémonique du capitalisme. Un peu partout, avec les mêmes mots d’ordre et les mêmes moyens, on reconvertit les «bassins» industriels en «vallées» de la connaissance.
Dans les années 1970, la technopole a fait figure d’utopie née de la critique de la société industrielle : critique de la bureaucratie, de la hiérarchie, de l’urbanisation galopante et de la pollution. Quand Pierre Lafitte, ingénieur général des mines, sénateur des Alpes-Maritimes, fonde en 1968 la première technopole française, Sophia-Antipolis, ce grand campus verdoyant au large de Nice se veut «un Quartier latin aux champs, un lieu de réflexion, de création, mais aussi de défoulement où scientifiques et ingénieurs côtoient les artistes2». On ne travaillerait plus à la chaîne, on «créerait» dans l’ambiance décontractée de campus ombragés, véritables «zones vertes pour matière grise». Libérés de l’asphyxie des grands groupes, les citoyens deviendraient de petits entrepreneurs libres de s’associer et de s’entraider sur des «projets».
C’est au début des an–nées 1980 que le modèle de la Silicon Valley voit consacrée sa victoire économique et idéologique en France. Philippe Merlant note que l’idée de la technopole bénéficie, pour réconcilier toute une génération de soixante-huitards avec l’entreprise, de sa «filiation avec les mythes californiens des années 1970». «Faut-il s’étonner, écrit-il, que cette génération, nourrie de l’idéologie gauchiste et massivement reconvertie dans les secteurs de la com’, ait été le principal vecteur médiatique de l’intérêt des technopoles ?»
Étrange ironie. On constate aujourd’hui que l’essor de ce modèle fondé sur la micro-électronique et l’informatique, loin de permettre une sortie par le haut du capitalisme industriel, lui a au contraire permis de prendre une ampleur inégalée. Loin de conduire à une sortie du travail à la chaîne, cette nouvelle étape lui donne au contraire une impulsion inouïe : sur toute la surface du globe, les usines se multiplient pour produire puces électroniques, i-Pad et autres i-Phone «développés» par les chercheurs et les entrepreneurs de toutes les Silicon Valley du monde. L’observateur des technopoles est, à bien des égards, du «bon côté» de la division internationale du travail : il y a longtemps qu’on ne produit plus de puces de silicium dans la baie de San Francisco et que la mine de Mountain Pass, en Californie, ne lui fournit plus de terres rares. En partie invisibilisées par cette conversion des anciennes puissances industrielles à la soi-disant «économie immatérielle», l’exploitation et la pollution intrinsèques à ce modèle n’ont jamais été aussi générales et aussi démesurées.
Dans une enquête menée par une ONG de Hong-Kong sur les vagues de suicides dans les usines Foxconn, où est produit l’essentiel de l’électronique actuelle, on apprend que le jour de leur recrutement, les ouvriers fraîchement débarqués de leur campagne se voient raconter, à des fins d’édification, les vies d’entrepreneurs tels que Steve Jobs et Bill Gates. L’invocation jusque dans les ateliers chinois de ces étudiants des campus de la Côte ouest, qui, soi-disant «partis de rien», ont fondé leurs entreprises dans des garages californiens – Hewlett Packard (Palo Alto, 1939) ; Apple (Cupertino, 1976) ; Google (Menlo Park, 1996) – illustre la puissance avec laquelle les mythes fondateurs du rêve américain se sont renouvelés et propagés à travers l’informatique. Alors que les inégalités sociales explosent depuis trente ans, les figures légendaires de la Silicon Valley ont donné une nouvelle jeunesse à la légende de la réussite individuelle par le mérite, renforçant dans le monde entier l’adhésion au capitalisme.
Les origines du nouveau rêve américain
La Silicon Valley a pour origine matérielle et idéologique l’effort de guerre américain. Sur le plan de la structure, d’abord, basée sur la proximité physique et les échanges informels entre chercheurs et ingénieurs, recherche et industrie. Elle est en quelque sorte l’héritière de l’OSRD, bureau national de recherche fondé par Roosevelt et l’ingénieur Vannevar Bush en 1940, où scientifiques et ingénieurs de toutes disciplines, industriels et militaires, sont immergés dans un bouillon de culture destiné à obtenir des résultats le plus rapidement possible. Elle hérite également de l’expérience du Radiation Laboratory, le Radlab, sur le campus du Massachusetts Institute of Technology (MIT), où 3 900 chercheurs et techniciens, dans une ambiance pluridisciplinaire et peu hiérarchique, s’activent pour trouver des moyens techniques de défendre l’Angleterre contre les bombardiers allemands. C’est cette expérience auréolée de succès, toile de fond du perfectionnement des radars, avions et ordinateurs et de la première explosion atomique, que Frederick Terman, chairman du département d’Electrical Engineering de Stanford, va reproduire telle quelle sur son campus après la guerre. Devenu vice-président de la célèbre université, il va faire de Stanford une école d’ingénieurs d’élite destinée à alimenter l’industrie. Il crée un parc technologique pour accueillir les firmes qui veulent collaborer avec l’université et faciliter la création de petites entreprises innovantes. «L’interaction était totale», raconte Michael Borrus, entrepreneur et ex-professeur d’ingénieurie à Berkeley, Californie. «17 entreprises – Hewlett-Packard3, Texas Instruments, IBM… – s’étaient engagées à verser 5 000 $ par an pendant cinq ans pour participer à un vaste programme d’échange d’informations en solid state electronics» et «la moitié des étudiants étaient en fait des employés des labos industriels, qui partageaient leur temps entre Stanford et l’entreprise4…» Au moment où la guerre froide fait affluer les capitaux militaires, c’est dans cette zone que s’installent tous les sous-traitants de la NASA. Entre 1955 et 1968, la production de semi-conducteurs pour les circuits électroniques des systèmes de l’aérospatiale passe de 15 à 294 millions de dollars. En 1968, David Packard, fondateur de la firme éponyme, devient le secrétaire à la Défense du président Nixon, tandis que des ex-fonctionnaires de la Défense créent la firme Texas Instruments.
Précisons que l’ambiance pluridisciplinaire propre à la Silicon Valley, sa façon de valoriser et de parier sur les contacts informels, que l’on va retrouver dans l’organisation du travail des grands groupes (horaires souples, repas gratuits, piscine à balles…), n’a jamais concerné que la matière grise – cadres, chercheurs et ingénieurs. L’association américaine de l’électronique a toujours été farouchement antisyndicale et n’a pas particulièrement tenté d’améliorer les conditions de travail des Chicanos, Philippins et Vietnamiens qui produisaient l’électronique de la Baie avant les délocalisations en Asie.
La technopole, une utopie cybernétique
Sur le plan de l’héritage intellectuel, l’essor des technologies de l’information et de la communication a pour toile de fond le mouvement cybernétique, courant intellectuel qui se développe à partir des années 1920, fondé sur l’idée que l’individu est un être de communication comparable à une machine de calcul. L’œuvre la plus déterminante du courant est celle de Norbert Wiener, célèbre mathématicien du MIT et élève de Vannevar Bush, avec qui il a travaillé pendant la guerre au Rad Lab sur la commande de tirs. Dès 1948, Wiener tente de développer une machine capable d’imiter le cerveau humain. Il emploie le terme «cybernétique» (du grec kubernetiké, «l’art de gouverner») pour désigner l’«étude des processus de contrôle et de communication chez l’être vivant et la machine». Cela lui permet d’unifier en une seule théorie les domaines de l’électronique, de l’automatique et la théorie mathématique de l’information mise au point par un autre mathématicien du MIT, Claude Shannon5. Ce courant constitue donc la matrice intellectuelle du monde de réseaux et d’informatique que nous connaissons aujourd’hui.
En permettant à des disciplines aussi diverses que la biologie, la psychologie, les mathématiques et l’électronique de trouver un langage commun, la cybernétique joue un rôle décisif dans l’interdisciplinarité qui caractérise ces nouveaux laboratoires de recherche appliquée. Mais surtout, comme le montre Philippe Breton dans son livre consacré à «l’utopie de la communication»6, elle constitue un véritable modèle de société pacifiée grâce à la circulation d’information.
Inspirée par les lois physiques de propagation de la chaleur, la cybernétique considère que l’ensemble de ce qui compose la nature a une tendance naturelle à l’entropie, c’est-à-dire au désordre, à la désorganisation et in fine au chaos. Pour Wiener, le seul moyen d’y faire face est de développer les systèmes d’information et d’augmenter la circulation de messages. D’où la nécessité de développer des «machines computationnelles» qui augmenteront la vitesse de traitement des messages. La cybernétique devient donc l’arrière-plan théorique d’un nouveau déterminisme technologique : plus la circulation de l’information augmentera, grâce aux machines qui la traitent, plus on fera reculer le conflit et le chaos7.
Soulignons que, malgré le rôle déterminant joué par la science dans l’ampleur des massacres de 1939-1945, les philosophies qui vont dominer le monde de l’après-guerre ne remettent pas en cause le développement technologique à l’occidentale, bien au contraire. Qu’il s’agisse de l’idéal de la société d’abondance, de la disparition du travail humain grâce aux robots ou de la société de l’information, l’Occident n’a jamais été aussi fasciné par l’augmentation de la puissance technique, même si tout un pan de la société d’après-guerre milite pour qu’elle soit mise au service de finalités humanistes (révolution verte, atoms for peace, etc.). Dans la même veine, la cybernétique est fortement marquée par une fascination pour les promesses sans limites de la machine, qui va de pair avec une perte de confiance, liée au traumatisme de la guerre, dans les capacités humaines à organiser la société. Idéalement, on disposerait même de systèmes de traitement de l’information à qui l’on pourrait confier le soin de gouverner, en toute objectivité. Un rêve que les algorithmes d’aujourd’hui, machines à brasser du big data, ont commencé à concrétiser.
Des hippies aux hackers, des hackers aux entrepreneurs
Si l’interdisciplinarité et l’importance des rapports informels issus de la science de guerre sont devenus aujourd’hui des ingrédients essentiels de la technopole, la Silicon Valley n’aurait jamais eu cet immense impact idéologique dans la mutation du capitalisme opérée il y a trente ou quarante ans sans son «esprit rebelle». Aujourd’hui encore, alors même que la création de start-up est devenue une sorte de Graal pour l’ensemble de la classe politique et la totalité du monde industriel, cet univers s’énonce comme un monde «disruptif» qui vient bousculer privilèges et routines. Leurs créateurs se présentent comme des figures épiques, luttant à armes inégales contre de grandes firmes capitalistes pour créer les nouveaux produits qui révolutionnent vraiment la vie des gens. D’où vient cette aura de transgression ?
Pour la sortie du premier Macintosh, en 1984, Apple a fait réaliser par Ridley Scott un spot qui sera consacré meilleure publicité du siècle par la presse américaine. On y voyait une masse d’individus tous alignés, gris et amorphes face à un ordinateur géant, absorbant passivement un discours. Sur l’écran, Big Brother, figure du célèbre roman d’Orwell, leur aboie sa propagande. Soudain, une jeune femme vêtue de rouge fend les rangs et, d’un coup de masse, fait voler l’écran de l’ordinateur en éclats avant d’être capturée par des policiers. Le film était suivi de ce message : «Le 24 janvier, Apple Computer lance le Macintosh. Vous allez voir pourquoi 1984 ne ressemblera pas à 1984.»
Cette publicité saisissante nous rappelle que l’informatique a longtemps incarné un monde bureaucratique et déshumanisé, un instrument de contrôle social. Rejeton de la recherche nucléaire issue de la Seconde Guerre mondiale, elle est considérée comme un pur produit de ce qu’on appelait dans les années soixante le «complexe militaro-industriel»8. En fait, la Silicon Valley ne serait jamais devenue le centre de la mutation du capitalisme opérée il y a trente ans sans l’intervention de la culture «hacker», qui, dès la fin des années 1970, invente l’informatique personnelle que nous connaissons.
Dans son histoire des racines contestataires de l’industrie du numérique9, Fred Turner, professeur à Stanford, retrace la trajectoire de Stewart Brand, personnage-clé de la contre-culture qui deviendra un pionnier des communautés virtuelles et le cofondateur, à San Francisco en 1993, du magazine techno-libéral Wired. Cette biographie est l’occasion de réaliser une étonnante généalogie culturelle et politique de la Silicon Valley, dans laquelle est décrit le croisement de deux cultures initialement distinctes : celle des geeks des labos de Stanford, du MIT et des grandes firmes (Xerox Park) et celle d’une frange hippie revenue de ses expériences communautaires néo-rurales.
En effet, si toute une mouvance contestataire liée au mouvement contre la guerre du Vietnam, inspirée par le mouvement des droits civiques, s’efforce de transformer l’organisation sociale, une autre, plus artiste que militante, mise plutôt, pour agir sur les consciences, sur des moyens techniques – tels les drogues et les spectacles psychédéliques10. Or Fred Turner montre que ce dernier courant, ici schématiquement présenté (car il va de soi que les deux courants n’ont rien d’hermétique et ont pu traverser les mêmes individus), est en partie héritier de la même tradition intellectuelle que les jeunes informaticiens, à savoir la cybernétique. Par exemple, tous semblent avoir lu Marshall McLuhan, qui, dans son best-seller Le medium est le message, paru en 1967, décrit l’avènement du «village planétaire» grâce aux technologies de l’information. Ainsi, Stewart Brand fait partie de ceux qui ont vu dans l’ordinateur «un LSD d’un genre nouveau» et dans les premiers réseaux d’échange électronique les outils idéaux pour construire des communautés de petite échelle tournant le dos à la société de masse.
Si la perception de l’ordinateur s’est presque inversée entre les années 1960 et 1980, c’est lié à cette rencontre qui va sceller l’identité de la communauté hacker11. En détournant les grosses machines de calcul centralisées d’IBM et de Hewlett-Packard au profit du développement personnel, de la mise en réseau et de la créativité, ce sont ces jeunes informaticiens initiés aux valeurs de la contre-culture qui inventeront l’informatique personnelle que nous connaissons. Ainsi, Steve Wozniak et Steve Jobs, deux électroniciens californiens à l’origine d’Apple, ont commencé leur collaboration en vendant un appareil permettant de pirater la société de télécoms AT&T pour passer des appels longue distance gratuitement. Dans un texte paru dans la Whole Earth Review en 1985 sous le titre «Comment l’éthique hacker crée et façonne l’économie de l’information», Stewart Brand lui rend un hommage enthousiaste : «Je ne connais aucun autre groupe qui se soit formé pour libérer une technologie et qui y soit parvenu. Après avoir été accueillis dans l’indifférence la plus totale par l’industrie nationale, ils ont amené cette dernière à finalement adopter leur manière de faire. En remettant l’individu au cœur de l’âge de l’information, grâce à l’ordinateur personnel, les hackers ont sans doute sauvé l’économie américaine. Aujourd’hui, les hautes technologies ne sont plus subies par les consommateurs, ils s’y investissent en masse. La plus discrète des sous-sous-cultures des années 1960 finit par apparaître comme la plus innovante, la plus puissante12…»
De la «technologie conviviale» au «monopole radical»
Ce que cette généalogie met en relief, c’est que la micro-informatique a représenté dans les années 1970 une «technologie douce» qui permettrait de lutter contre les travers du monde industriel. Son développement coïncide avec un puissant mouvement de contestation de la société industrielle, entamée à la fin des années soixante et au faîte de sa diffusion au tout début des années 1980. L’Homme unidimensionnel, le livre le plus connu du philosophe Herbert Marcuse, paraît en 1964, analysant l’intégration aliénante des individus à un système de production fondé sur de faux besoins. Le Club de Rome, qui publiera son célèbre rapport sur les limites de la croissance en 1972, est créé en 1968. Small is beautiful, un des livres les plus cités de la décennie, traduit en plus de 100 langues, paraît en 1973. Écrit par Schumacher, un ancien directeur de l’autorité anglaise du charbon, il plaide pour la décentralisation politique et technique, et développe les concepts d’énergie renouvelable, de relocalisation de l’économie et de «technologie appropriée» par opposition à l’irrationalité du gigantisme industriel. Autre exemple, l’œuvre d’Ivan Illich, prêtre catholique croate émigré aux Etats-Unis puis à Porto-Rico, auteur d’un célèbre essai paru en 1971, La Convivialité, critique la croissance ininterrompue et la sophistication des technologies, devenues contre-productives du fait de leur démesure. Enfin, dans le «Who’s Who international» du mouvement des technologies douces publié par la revue Autrement en 1980, Stewart Brand, auteur d’un recueil intitulé Soft Tech et publié en 1978, est présenté comme «un des plus célèbres propagandistes des technologies douces». Le statut de l’informatique à l’époque est d’ailleurs éclairé de façon éloquente par la couverture de ce numéro spécial «Technologies douces», où il est écrit : «Solaire, biomasse, micro-informatique… Des outils pour chacun, une nouvelle politique ?»
Les «technologies alternatives», écrit Gérard Blanc, fondateur de la revue Coévolution, version française de CoEvolution Quarterly, créée par Stewart Brand en 1974, s’opposent «aux technologies conventionnelles dominantes dans les pays industrialisés, et à leurs caractéristiques essentielles : forte centralisation et automatisation des systèmes de production, haute technicité et spécialisation, grande division du travail, forte consommation d’énergie et de matières premières non renouvelables, nécessité d’un contrôle étendu sur le personnel, les marchés et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre13». On ne peut que constater aujourd’hui que la microélectronique a produit le contraire de ce qu’on en attendait, et que chacune des caractéristiques contre lesquelles elle était censée lutter correspond au fonctionnement actuel de l’économie numérique. L’essor de l’électronique et de l’informatique ont permis un renforcement de la capacité des grandes firmes à gérer des masses de matières premières, de marchandises et de travailleurs d’un bout à l’autre du globe. La production s’est automatisée au point que rares sont les professions, même intellectuelles, à ne pas être concurrencées par les interfaces numériques. Le niveau de technicité et la spécialisation requis pour ne pas être frappé d’obsolescence par l’évolution de l’informatique nécessitent une course permanente. L’équipement en TIC requiert, de sa production à sa consommation, une quantité d’électricité croissante14. Sans parler des usines d’électronique dignes des romans de Charles Dickens, des enjeux géostratégiques autour des terres rares et de la saturation de l’espace public par le plébiscite du numérique.
De la même manière, il est ironique de voir à quel point la décennie 1970 a engendré une technologie correspondant précisément au concept de «monopole radical» qu’Ivan Illich oppose à la «technologie conviviale» : «Quand une industrie s’arroge le droit de satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque-là l’objet d’une réponse individuelle, elle produit un tel monopole. La consommation obligatoire d’un bien qui consomme beaucoup d’énergie (le transport motorisé) restreint les conditions de jouissance d’une valeur d’usage surabondante (la capacité innée de transit)15.» L’emprise de l’électronique sur les échanges humains, via la téléphonie mobile, le mail, Facebook et Twitter, la façon dont ces nouveaux usages structurent et saturent le monde actuel, ne restreignent-elles pas drastiquement cette valeur d’usage surabondante qu’est la capacité de parole, d’échange et de rencontre ?
Ironiquement, mais implacablement, la micro-informatique, autour de laquelle s’est structurée l’utopie cybernétique qu’est la technopole, censée résoudre les contradictions du monde industriel, s’est retournée en moyen de sa pérennisation et de son accroissement. Le travail à la chaîne le plus abrutissant est plus que jamais de mise dans les usines d’électronique et les plates-formes d’appel. Il n’y a jamais eu sur la planète autant de paysans qui quittent leurs terres vers les villes pour produire à l’échelle mondiale les objets issus des «idées» qui ont germé dans les technopoles. Ce que dissimule la fable platonicienne d’une économie propre et immatérielle fondée sur la connaissance, c’est l’extension ininterrompue de l’usine-monde.
———–
1. «Technopolis : L’explosion des cités scientifiques»,
dir. Yann de Kerorguen et Philippe Merlant, novembre 1985, n° 74. Autrement est une revue de sciences humaines fondée en 1975, à l’origine des actuelles éditions Autrement.
2. Le Monde, 2 août 1960.
3. En 1937, Richard Terman aurait lancé à deux de ses élèves : «Messieurs Hewlett et Packard, vous devriez créer une entreprise !»
4. Autrement, novembre 1985, p. 37-39.
5. En 1948, Claude Shannon, dans A Mathematical Theory of Communications, invente une théorie probabiliste permettant de déterminer la quantité d’information contenue dans un message, en fonction de sa «redondance» et du «bruit».
6. L’Utopie de la communication : le mythe du «village planétaire», La Découverte, Paris, 2004.
7. La communication joue ainsi le même rôle que le concept de «doux commerce» (Montesquieu) dans la tradition libérale, qui postule que les individus et peuples liés par des échanges commerciaux tendent mécaniquement à coexister en paix.
8. Sur l’histoire de l’essor conjoint de l’informatique et de la bureaucratie, lire La Liberté dans le coma, du Groupe Marcuse, éditions La Lenteur, 2012, chapitre 1.
9. Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique : de la contre-culture à la cyberculture, C&F éditions, Caen, 2012.
10. Installations son et lumière destinées à créer un bombardement sensoriel qui, associé à l’usage de LSD, étaient considérées comme un outil de modification de la perception et par là, de libération personnelle. Les premières soirées psychédéliques sont lancées par les Merry Pranksters qui, au début des années 1960, parcourent la Californie dans un bus multicolore (l’histoire est racontée par Tom Wolfe dans son roman Acid Test).
11. La plus ancienne occurrence du verbe to hack (littéralement, bidouiller) au sens de «piratage» remonterait à 1963 : il est employé dans le journal des étudiants du MIT (The Tech, 20 nov. 1963) pour désigner un piratage des lignes téléphoniques permettant de téléphoner gratuitement.
12. Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique, op. cit., p. 223.
13. «Technologie appropriée/appropriable : le mot et la chose», Autrement, n° 27, octobre 1980, p. 11.
14. «L’arrivée des TIC dans la vie quotidienne des Français s’est traduite par un (…) accroissement de 635 kWh par ménage et par an, soit 20% de la consommation de 2008.» Lire à ce sujet La Face cachée du numérique, L’Echappée, Paris, 2013.
15. Ivan Illich, Énergie et équité, Seuil, Paris, 1975.